
L’apocalypse numérique n’aura pas lieu : ce livre est né d’une colère et de deux espoirs
Ma colère a une cible : les prophètes de malheur, les hurleurs professionnels si doués à exploiter le filon de leurs propres hurlements. A les entendre, la fin du monde va être précipitée par le « numérique » – un mot derrière lequel ils rangent pêle-mêle l’informatique, le web, les robots, l’intelligence artificielle, le progrès technologique… Certains estiment par exemple que l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle sont vouées à se faire la guerre – une guerre que remporterait forcément l’intelligence artificielle, notamment grâce au big-data, toutes ces données sur lesquelles elle s’appuie et que nous lui livrons sans discernement. Les formations dans les secteurs informatique et numérique ne serviraient donc plus à rien, puisque nous sommes voués à être remplacés par les robots. Or, comme j’aurai l’occasion de l’expliquer dans ce livre, l’intelligence artificielle est fondamentalement dépendante de l’intelligence humaine. Aussi y aura-t-il toujours besoin de former des développeurs et des informaticiens de tous niveaux, techniciens de base comme codeurs d’élite, notamment pour construire ces fameux robots. Et le mieux que l’on puisse faire, c’est initier le plus tôt possible l’intelligence humaine à maîtriser l’intelligence artificielle, en apprenant par exemple aux enfants à coder. Ce faisant, on ne les « détermine » pas à être des geeks ou des esclaves de l’informatique, comme je l’entends souvent : ce n’est pas parce qu’on leur apprend à coder qu’ils deviendront tous développeurs professionnels !
Cette colère a aussi un nom – enfin, un nom, c’est beaucoup dire : il s’agirait plutôt d’une onomatopée. C’est le tétragramme de la secte des nouveaux demi-savants, pour reprendre l’expression de Pascal : l’acronyme GAFA. Ce véritable concentré de fake news a deux effets, aussi préjudiciables l’un que l’autre. Le premier est de « simplifier » -sauf qu’à trop simplifier, on mélange tout. Le deuxième effet est de créer un objet médiatique auquel on va pouvoir accrocher toutes sortes de fantasmes, de préjugés, de contre-vérités.
En réalité, Google, Amazon, Facebook et Apple n’ont rien à faire ensemble – ou alors il faudrait leur adjoindre des milliers d’autres entreprises qui partagent des caractéristiques communes, d’ailleurs fort vagues (chiffre d’affaires élevé, dimension internationale, tropisme technologique…). En effet, Apple et avant tout un fabricant de matériel, Google (1) un moteur de recherche, Amazon un magasin en ligne, Facebook un réseau social.
Certes, comme toutes les firmes de dimension planétaire, qu’elles appartiennent ou non, d’ailleurs, à l’économie numérique, ces quatre-là représentent des défis importants pour nos sociétés et nos institutions. Sur le plan fiscal, ils sont accusés de profiter du dumping pratiqué par certains Etats et d’échapper ainsi à l’impôt dans les pays à taux élevé de prélèvements obligatoires. Sur le plan de la sécurité, un halo d’incertitude, voire d’opacité, entoure certaines de leurs activités. Il est vrai, d’ailleurs, que tous recueillent et exploitent des données, mais selon des modalités et pour des objectifs très différents. Leur culture d’entreprise, leur politique de relation avec leurs clients et utilisateurs, leur conception des intérêts privés et du bien commun sont extrêmement dissemblables. Comme l’explique le journaliste spécialisé Julien Cadot, « quand on est une collectivité ou une ville, ce n’est pas du tout la même chose de monter un projet avec Google (plusieurs centaines d’employés à Paris, allant de la communication à la recherche) qu’avec un Facebook (petits bureaux, compétences très orientées business) ou un Amazon qui a à la fois des bureaux mais aussi des entrepôts à Paris, allant de la communication à la recherche) qu’avec un Facebook (petits bureaux, compétences très orientées business) ou un Amazon qui a à la fois des bureaux mais aussi des entrepôts et des livreurs et qui opère donc à plusieurs niveaux avec des tas de problématiques et d’interlocuteurs différents (2). Et d’ailleurs, loin de constituer un « cartel » qui, en vertu d’une sorte de Yalta numérique, se partagerait la domination d’Internet, et donc du monde, ces quatre entreprises sont, entre elles, des concurrents impitoyables.

Remarquons que, si on diabolise les GAFA, c’est souvent pour mieux diaboliser la révolution numérique elle-même. Ainsi, si l’on en croit les oiseaux de mauvais augure qui commentent plus qu’ils agissent, la révolution numérique serait synonyme de déshumanisation, d’insécurité et de déstabilisation économique. Le problème, c’est qu’il existe un hiatus abyssal entre ce triple catastrophisme et le quotidien des usagers, déjà prêts à accueillir et, mieux encore, à entreprendre la révolution numérique, ici et maintenant.
C’est mon premier espoir. La révolution numérique, ce n’est pas plus de déshumanisation ; c’est au contraire l’opportunité de réhumaniser l’existence, en redonnant de la valeur à ce qui fait la spécificité de l’être humain, dans l’éducation, la recherche, les affaires, la politique, l’aménagement du cadre de vie… La révolution numérique, ce n’est pas plus d’insécurité ; c’est au contraire l’opportunité de relever le défi de la sécurité, pour que l’être humain exploite le numérique et ne soit pas exploité par le numérique. La révolution numérique, ce n’est pas la déstabilisation économique ; c’est au contraire l’opportunité de refonder l’économie sur de nouvelles bases, au service de la croissance et du profit, mais aussi, et surtout, de l’épanouissement des individus. On peut, certes, continuer à se faire peur, à brosser un tableau désespérément anxiogène, mais il faudra alors assumer un risque majeur : accentuer le retard de notre pays, décourager la jeunesse déjà en symbiose avec le nouveau monde et, finalement, se priver d’écrire une nouvelle page de notre histoire – une grande page, j’en suis convaincu.
Car la révolution numérique – c’est mon deuxième espoir – occasionne un véritable changement de la condition humaine. Au fond, tout le propos de ce livre est d’expliquer pourquoi la révolution numérique ne se limite pas à un changement d’outil ou de matériau, comme on est passé, à l’aube du premier millénaire avant notre ère, de l’âge du bronze à l’âge du fer ; à la fin du XIX siècle, de la vapeur à l’électricité ; dans les années 1970, de la machine à écrire au micro-ordinateur.
On assimile parfois numérique et informatique. C’est un contresens, une erreur de perspective. Certes, ces deux mots sont apparus dans des contextes voisins (3) et évoquent des réalités étroitement imbriquées. Mais cette confusion terminologique, même mineure, peut altérer, voire empêcher, l’analyse pertinente du sujet. Numérique et informatique ne sont pas des notions interchangeables. Elles entretiennent même un rapport que je qualifierais de hiérarchique : l’une désigne une réalité plus importante que l’autre. Plus décisive, plus cruciale, plus déterminante pour nous, êtres humains, qui la vivons au jour le jour.
Comme l’explique Gilles Babinet (4), non seulement la révolution numérique n’est pas qu’une révolution technologique, mais elle vise même à « effacer la technologie », en la rendant, sinon invisible, en tout cas très discrète dans notre quotidien. Le numérique est semblable à l’électricité : quand on veut de la lumière, il suffit d’appuyer sur un bouton, et l’on n’est pas conscient de tout ce qu’implique et suppose ce simple geste, de la conception des centrales nucléaires à la maîtrise des matériaux conducteurs. Il en va de même pour le numérique. Ce qui compte, en réalité, ce ne sont pas les appareils complexes, mais les usages simples auxquels ils répondent et correspondent. L’économie dans laquelle nous entrons, comme l’ont mis en lumière Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet dans un rapport de 2006 qui n’a rien perdu de son actualité, c’est l’économie de l’immatériel, où « la capacité à innover, à créer des concepts et à produire des idées est devenue l’avantage compétitif essentiel (5) ».
Le corollaire de l’économie de l’immatériel, c’est ce qu’on appelle l’économie de l’usage, ou économie de fonctionnalité, dont le numérique est à la fois l’architecture et le carburant. Elle consiste à substituer à la notion de propriété du bien celle de droit d’usage du bien. Ce qui est vendu, ce n’est plus la matière elle-même, mais sa fonctionnalité. Les déclinaisons se multiplient : les éditeurs ne vendent plus seulement des objets « livres », mais le droit de les lire sur liseuse ou tablette (6) ; les industriels comme Michelin ne vendent plus des pneus, mais leur usage, c’est-à-dire des kilomètres parcourus ; l’entreprise Clarlight ne vend pas des ampoules mais la lumière que produisent ses propres inventions, connectées à Internet, ce qui dispense les consommateurs d’acheter les équipements. Et l’on pourrait également citer Uber, pour les déplacements, ou Airbnb, pour les locations saisonnières… Sans le numérique, qui permet de recueillir les données d’utilisation en temps réel, cette économie de l’usage est une coquille vide.
La révolution numérique est donc une révolution anthropologique, qui va jusqu’à changer la condition humaine. « Changer la condition humaine » … n’est-ce pas exagéré ? Non, car la condition humaine, c’est la façon dont les êtres humains mènent leur existence ; or, la révolution numérique bouleverse toutes les dimensions de notre existence. « Changer la condition humaine » … cela doit-il nous faire peur ? Non plus, car c’est une métamorphose que nous pouvons et devons non seulement contrôler, mais décider, initier, orienter, sublimer. L’histoire montre que l’être humain ne s’inflige jamais durablement ce qu’au fond de lui il ne souhaite pas. « Changer la condition humaine » … est-ce la promesse d’un Grand Soir 2.0, un nouvel horizon idéologique, un dessein à mettre en œuvre coûte, au forceps s’il le faut, à l’image de tous ceux qui ont ponctué le siècle dernier et charrié tant d’illusions déçues et de drames ? Non, car la révolution numérique n’est pas écrite par avance, elle sera ce que chacun de nous en fera. Et non, car la révolution numérique n’est pas le rêve – ou le cauchemar – de quelque gourou, elle s’appuie sur les opportunités qu’offre le réel.
Oui, le réel. C’est-à-dire ce qui existe, sous nos yeux, ici et maintenant. Pas ce qu’espèrent les « é-béats » ni ce que craignent les « e-sceptiques », pour reprendre les mots du journaliste et ingénieur Sébastien Elka. Les uns comme les autres vivent sur une autre planète. Ils sont dans la prédiction, pas dans l’actio. D’où viennent leurs certitudes, qu’elles soient roses ou noires ? Mystère… La moitié des dirigeants des plus grandes entreprises du numérique planétaire déclarent eux-mêmes ne pas savoir à quoi ressemblera leur secteur dans trois ans (7), mais le moindre intellectuel pourvu d’un compte Twitter s’érige en Nostradamus digital et livre ses prophéties urbi et orbi !
Pour que la révolution numérique porte ses fruits, il va falloir des changements. Ces changements doivent être individuels (initiatives, état d’esprit) et collectifs (réformes). D’abord, il faut accepter le caractère inéluctable de cette révolution et se positionner intelligemment à son endroit. Face au tsunami du numérique – qui vient du large, comme tous les tsunamis, ce qui périme d’avance les approches nationalistes ou souverainiste -, on peut adopter trois attitudes. Les deux premières consistent à le regarder avec des yeux fascinés et un sourire béat, ou à tenter de l’arrêter en levant les poings. Dans un cas comme dans l’autre, on est emporté par les flots. Je propose une autre option : surfer. Non pas minorer la puissance de la déferlante, encore moins l’affronter de face, mais l’utiliser pour avancer, s’élever, accélérer, et même s’amuser, créer des figures, prendre du plaisir. Révéler son courage, sa créativité, sa dextérité. Et le faire maintenant, car on ne met pas un tsunami sur pause, comme l’a cru l’entreprise Kodak il y a trente ans : dépositaire des premiers brevets de photo numérique, elle a tardé à les exploiter en se disant qu’elle le ferait plus tard, histoire de profiter « encore un peu » de sa position ultra-dominante sur le marché. Plus tard, mais trop tard. Elle a manqué le virage et s’est littéralement effondrée.
Les réformes politiques, économiques et sociales à mener pour tirer profit de la révolution numérique sont immenses, comme nous le verrons. Elles ne doivent conduire à éluder aucune question – notamment La question que posent toutes les révolutions : quid de celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas suivre le mouvement ? Toute révolution risque de comprendre une part sacrificielle. Eh bien, justement, ma révolution est peut-être la seule révolution dans l’histoire de l’humanité à apporter une solution à chacun des problèmes qu’elle soulève, car elle n’institue pas de clivages indépassables. Au contraire, elle associe, combine, conjugue, selon une logique du et et non du ou.
Une autre question majeure est celle de la sécurité : comment avoir confiance dans un phénomène qui semble se jouer de tous les cadres politiques, sociaux, culturels auxquels nous sommes habitués ? Là encore, la réponse est dans la question : la révolution numérique est à elle-même sa meilleure sécurité, car elle met à notre disposition des moyens inédits de garantir à la fois la performance et la liberté individuelle. Pour cela, bien sûr, il faut être décidés à les utiliser, à en faire la promotion, à y former toutes celles et tous ceux qui, parfois légitimement, confondent complexité et anarchie. Oui, la sécurité de la collecte, de la circulation et du stockage des données numériques exige des protocoles très élaborés, mais cette sophistication ne masque aucun mystère, aucun flou, aucun vice caché. Au contraire, elle est indispensable à l’efficacité de la protection contre le piratage, les virus, les fuites généralisées.
Au fond, non seulement la révolution numérique crée un nouveau monde, mais elle donne à chacun d’entre nous les moyens de le construire, le façonner, en toute liberté. En toute liberté, cela signifie que cette forme peut être mauvaise, d’autant plus si elle n’est qu’un copier-coller de ce qui existe déjà, simplement « packagée » de manière différente. Il nous appartient d’en faire ce que nous voulons qu’elle soit.
Guy Mamou-Mani
https://youtu.be/9d1VeWyYJfw
1) Qu’il convient de distinguer d’Alphabet, sa maison-mère aux activités extrêmement variées.
2) Julien Cadot, « Si vous souhaitez être crédibles, arrêtez de dire « les GAFA », Numerama, 27 janvier 2017.
3) Le mot « informatique » a été créé en 1962 par Philippe Dreyfus, ancien vice-président de Cap Gemini Sogeti, à partir de la contraction des deux termes « INFORMATION » et « AUTOMATIQUE », pour signifier le processus de traitement des données.
4) Voir ses ouvrages, tous publiés au Passeur : L’Ere numérique. Un nouvel âge de l’humanité (2014) ; Big-data. Penser l’homme et le monde autrement (2015) ; Transformation digitale. L’avènement des plateformes (2016)
5) Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet, L’Economie de l’immatériel. La croissance de demain, La Documentation française, 2006.
6) Même si, sur le plan juridique, le fichier devient la propriété du lecteur.
7) « Emerging Technologies’ Impact on Society & Work in 2030 », Institute for the Future/Dell, juillet 2017.



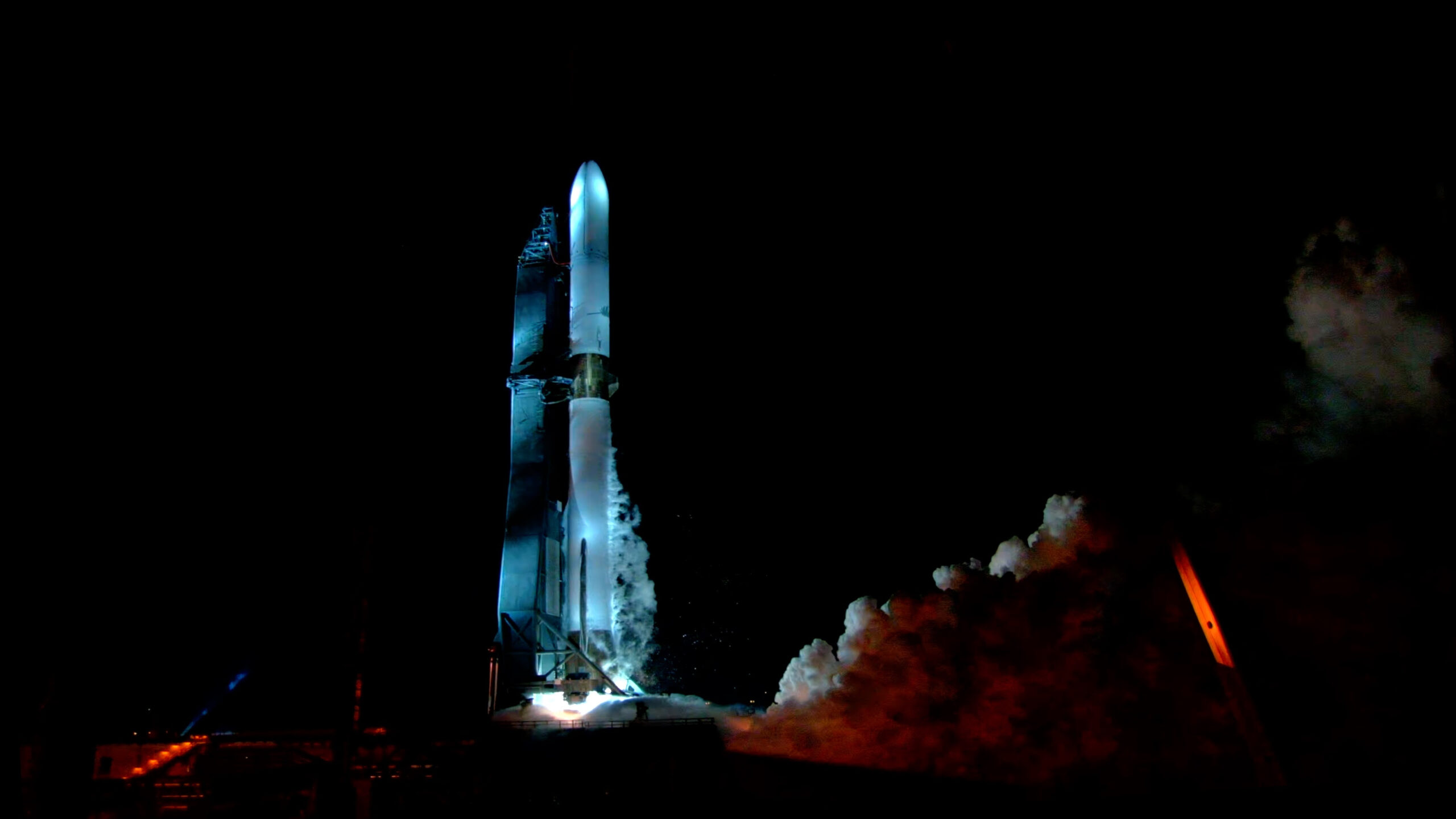
Cédric Leboussi
5