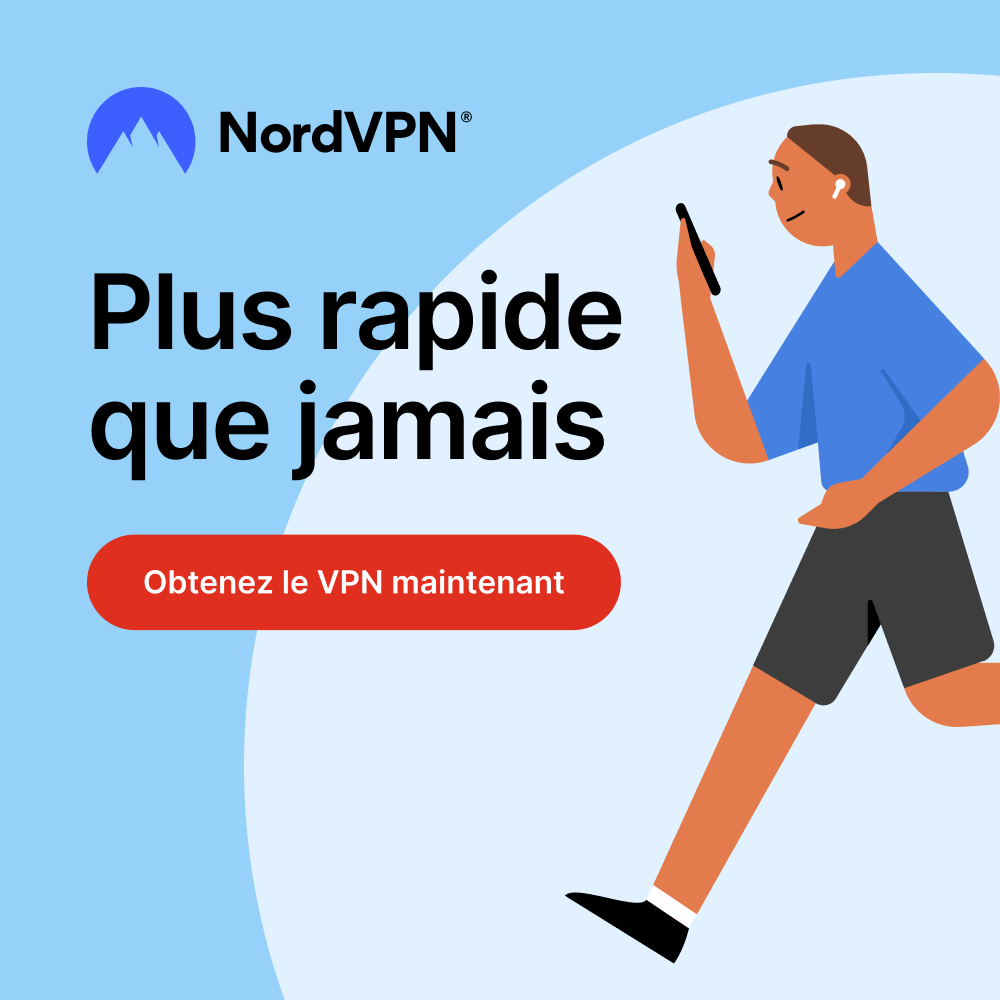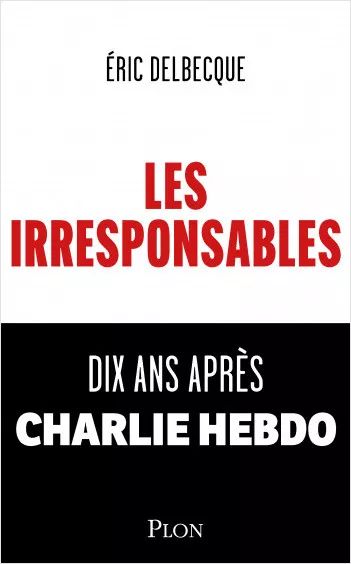Société militaires privées : le business juteux des « contractors »

Les mercenaires d’aujourd’hui seront-ils les casques bleus de demain ? La question mérite désormais d’être posée. En 1998, le secrétaire général des Nations Unies reconnaissait avoir envisagé la possibilité de faire appel à des sociétés militaires privées (SMP) pour assurer la sécurité des camps de réfugiés de Goma. Cinq ans plus tard, le même Kofi Annan exerça une pression auprès du gouvernement français en lui demandant d’assurer le commandement d’une opération multinationale dans l’Est du Congo, faute de quoi il serait dans l’obligation d’accepter les services que lui proposait l’International Peace Operation Association, consortium de sociétés militaires privées américaines.
En 2002, Enrique Bernales Ballesteros, le rapporteur du comité spécial des Nations Unies chargé d’examiner la question de l’utilisation de mercenaires, pouvait encore considérer que leurs activités violaient les droits de l’homme et empêchaient l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination. Six ans plus tard, le groupe de travail des Nations Unies sur l’utilisation de mercenaires soulignait à l’issue de sa troisième session la nécessité de «créer de nouvelles normes juridiques internationales afin de réguler les activités de mercenaires et des compagnies privées de sécurité militaire».
Les modernes contractors retrouvent ainsi leurs origines quand les auxiliaires et autres mercenaires suisses de l’Italie étaient recrutés par condotta (contrat) et conduits par un condottiere. Les entreprises qui les emploient n’ont plus que de très lointains rapports avec les « chiens de guerre » de la décolonisation. Ceux-ci sont en effet morts et ont été remplacés dans un premier temps par des sociétés créées par des officiers supérieurs démobilisés à la fin de la guerre froide. Ce mercenariat « entrepreneurial » est aujourd’hui en train d’évoluer, ces entreprises – lorsqu’elles ont réussi – étant revendues à des holdings dont elles constituent une fraction, souvent accessoire, du chiffre d’affaires. La sécurité tend ainsi à devenir un bien marchand ou un service ordinaire mis à la disposition d’acteurs privés ou publics, la demande publique étant au moins aussi importante que la demande privée.
Si l’étymologie du mot soldat nous ramène au soldius, une monnaie romaine en or, alors les modernes contractors viennent refermer une parenthèse au cours de laquelle les citoyens des nations postrévolutionnaires ont chèrement payé l’impôt du sang. Le débat ainsi ouvert est cependant loin d’être clair, tant les positions sont aussi idéologiques que confuses (la signification du terme privatisation est très différents entre les deux rives de l’Atlantique. Pour sortir de ces confrontations inutiles où les opinions inventent sans cesse de nouveaux arguments pour justifier le bien-fondé de leurs idées, il apparaît nécessaire de poser le problème autrement pour tenter d’aborder cette question si sensible en utilisant l’expérience historique sans être pour autant prisonnier du passé.
La privatisation de la sécurité constitue désormais une norme internationale
S’interroger sur la question de savoir si la privatisation de la sécurité constitue désormais une norme internationale qui s’inscrirait dans le cadre d’une nouvelle « bonne gouvernance » peut être une voie susceptible de changer notre regard. Cette manière d’aborder le problème permet une plus grande neutralité puisque le recours au mercenariat serait, dans ces conditions, imposé par notre environnement, constitué par des structures internationales sur lesquelles nous avons peu ou pas de prises aussi longtemps que nous ne sommes pas capables d’interagir avec elles. La notion de norme est, il est vrai, imprécise comme le rappellent Klaus-Gerd Giesen et Kees Van der Pijl dès l’introduction de leur ouvrage consacré aux « Normes Globales dans le XXIe siècle». Tant son énonciation que son application, sa création que sa diffusion, son contenu que son support demeurent incertains. La théorie des régimes, qui a introduit dans le domaine de la science politique l’étude de cette notion autrefois monopolisée par les juristes, n’a pas fourni de définition très précise en considérant avec Stephen Krasner que « les normes sont des critères de conduite définis en termes de droits et d’obligation ». Son support est tout aussi incertain, comme le montre l’article de Gary Goertz et Paul Diehl de 1992 sur la diffusion de normes éthiques portées par la communauté internationale et la nécessité d’étudier leur impact sur le comportement égoïste des acteurs